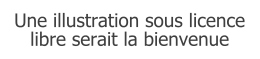Jean-Paul Delessard
Jean-Paul Delessard, né à Paris le , est un écrivain français.
Biographie
modifierIl est l’auteur de trois recueils de nouvelles : La Vie rêvée des anges, Le Cœur averse, Orbes noirs, de trois romans : Mémoire d'oiseau, la Vie d'Elsa (2016), " Mailer Daemon ou l'affaire De Valadouro/Ravenelle (2018) ainsi que d'une pièce de théâtre : Comment fais-tu l'amour Martine.
Dernier ouvrage publié en 2018 : " Motsments ".
Il vit et travaille en Bretagne. Ses quatre derniers livres ont été édités par Publibook - 175 bd A. France à St Denis
Références (extraits de " Motsments " )
modifierMOTS À MORT
Dieu n’aura pas à se plaindre
Une bouffée de chaleur montée de la chaussée déjà brûlante surprend Mina. Des voitures et des camions qui passent, des carrioles tirées par des ânes qui se fraient difficilement un passage dans l’encombrement de la rue soulèvent des voiles de poussière dorée qui dansent au-dessus du trottoir. C’est l’heure où des campagnes proches arrive une noria de véhicules aussi brinquebalants que surchargés de paniers de fruits et de légumes. Des voix tentent de se faire entendre au cœur de cette mêlée de véhicules fatigués, d’animaux effarés et d’humains qu’excite leur propre agitation. On crie, on s’interpelle, on vocifère. C’est chaque fois, chaque matin le même rituel, la même poussée de fièvre dont seule la chaleur qui devient atroce vers la fin de la matinée vient à bout.
Son père et ses deux oncles l’ont accompagnée jusqu’au seuil de leur logis qui donne sur une cour étroite avant de déboucher sur la rue. Les trois hommes ne sont pas allés plus loin. Ils ont immédiatement refermé la porte sur elle. Sa grand-mère, elle, n’a pas quitté son fauteuil. L’a-t-elle seulement vue partir ? On ne sait jamais si cette vieillarde, mère de son père, somnole ou bien veille, dort profondément ou guette en tapinois les gestes et les paroles des uns et des autres. Aigrie, injuste, exigeante, Sawan réserve à sa bru l’essentiel de la mauvaise humeur dont elle ne se départit guère. Mina n’a pas revu sa mère, son père n’y a pas consenti. Ses pleurs et ses petits gémissements de chat qu’on entendait au travers de la cloison avaient cessé. Ses deux frères avaient quitté le domicile beaucoup plus tôt qu’à leur habitude.
Mina ne répond pas au sourire de Roubâh, le petit marchand d’amandes grillées qui se tient du matin au soir à l’angle de sa maison. Elle en a voulu à son père qui a tenté de le chasser plus loin, lui, l’odeur et la fumée que dégage son petit commerce. En vain. Roubâh s’exécute, obtempère aux injonctions parfois violentes d’Abou Ali, disparaît quelques jours pour mieux se réinstaller ensuite, lui et son sourire irrésistible. Mais aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres, Mina a d’autres préoccupations d’une autre importance que le salut rendu à un petit vendeur d’amandes grillées. Dieu seul occupe son esprit, Dieu qui peut compter sur elle et qu’elle ne décevra pas, pas plus que son oncle Abou Assim qui parle si bien et dont le regard trouble, fiévreux lui fait parfois un peu peur. Ce Dieu à la grandeur incommensurable, Mina s’en est fait une idée bien à elle. Pour un peu elle prétendrait le connaître, l’avoir déjà rencontré. L’immense respect des siens pour cet être invisible l’en a empêchée mais elle, petite souris à peine arrivée sur terre, a de lui une image bien construite, belle, rassurante. C’est du haut du nouveau pont, celui qui a été reconstruit au lendemain de la guerre, qu’elle l’a vu, Lui. Lui, ce Dieu tellement présent dans chaque instant de l’existence de ses proches, dans leurs paroles et dans leurs actes. Lui, elle l’a vu émerger de l’eau du grand fleuve. C’était au début d’un printemps particulièrement doux, l’air tiède sentait la girofle et le jasmin. Elle passait sur le grand pont ce matin-là et elle L’avait vu dans la forme joliment spiralée d’une écharpe de brume qui s’élevait au-dessus de l’eau. Il était si beau, si élégant cet épi neigeux qui tournait lentement sur lui-même en s’élevant tandis que la lumière bleutée du petit matin traversait ses volutes argentées ! Elle l’avait suivi des yeux pendant un espace de temps dont elle aurait été bien incapable de fixer la durée. Une minute ou bien une heure, elle n’aurait pu le dire. Une sorte de vertige l’avait saisie et même légèrement faite vaciller. Et puis la nuée blanche avait cessé de tourner sur elle-même avant de prendre de la hauteur, de quitter la surface miroitante du fleuve et de se perdre dans l’azur du ciel. Elle n’en douta plus jamais, elle venait de voir, elle, Mina Ali, le Dieu de ses parents, celui qu’ils honoraient plusieurs fois par jour et rendaient responsable de leur destin, de ce qu’ils accomplissaient ou n’accomplissaient pas.
Mina se sent avancer sur le trottoir comme une petite mécanique bien réglée, à peine gênée par ce qui pèse un peu sur ses épaules. Il y a dans sa démarche une forme d’automatisme dont elle n’est pas complètement inconsciente. Pas assez lucide non plus pour faire le rapprochement entre ce qu’elle ressent et cette espèce de liqueur brunâtre qu’on lui a demandé de boire avant de sortir. Elle n’a jamais rien bu d’aussi sucré ! Un vrai caramel, une sorte de sirop écœurant dont elle a avalé un premier verre et refusé le second que son autre oncle, Bahar, lui tendait. Redoutant sans doute qu’elle ne vomisse, il n’a pas insisté.
Mina aime son quartier, s’y sent chez elle, en connaît les plus étroites des ruelles, les plus secrètes des placettes. Peu nombreux sont ceux de ses habitants ou de ses marchands qu’elle n’a pas déjà croisés, plus rares encore sont les boutiquiers ou les vendeurs du marché auxquels elle n’a pas, un jour ou un autre, acheté quelque denrée commandée par sa mère qui ne sort presque jamais.
Mina trottine en direction du marché d’Al-Sinek que moins de deux cents mètres séparent de son domicile. Elle se faufile dans cette foule qui se presse sur le boulevard et pense à sa mère, Areen. Areen – elle ne l’a appris que depuis peu – signifie « la pleine de joie » ce qui lui allait parfaitement bien. Et ne lui va plus du tout depuis que son regard plein de gaieté s’est figé, depuis que sa voix si douce qui lui a murmuré tant de mots tendres s’est voilée. Depuis que tel un fantôme noir et silencieux, elle s’est mise à errer dans sa maison, parfois au beau milieu de la nuit. Tout semble aller de travers d’ailleurs dans cette maison. Son père et sa mère se disputent pour des riens, ce qui ne leur arrivait jamais avant. Ils interrompent leurs querelles dès qu’elle approche mais ne s’adressent plus qu’à peine la parole entre deux altercations. Mina s’étonne d’entendre ainsi sa mère jusque-là si parfaitement soumise, comme toute bonne épouse se doit de l’être, résister à son père et lui tenir tête comme jamais elle ne se l’était permise. La fillette se souvient d’un soir de la semaine dernière où cette querelle dont le motif lui échappe a pris d’autres proportions. Aux cris avait succédé le bruit mat de coups portés par son père pris d’une fureur dont elle ne le savait pas capable. Mina s’était précipitée dans la pièce où elle avait trouvé sa mère recroquevillée sur le sol, effondrée entre une armoire et une commode, sa mère qui n’était plus qu’un pantin secoué de sanglots incoercibles. Son père avait quitté la chambre en maudissant celle « qui ne méritait pas le Dieu à la volonté duquel elle osait s’opposer ». Mina s’était blottie contre sa mère, à même le sol. Elles étaient restées-là, enlacées, mêlant leurs larmes jusqu’à ce que cessent les convulsions et les petits cris déchirants qu’émettait sa mère.
Depuis, Areen ne ressemble plus à celle que Mina a toujours connue, à cette grande femme si gaie et qui semblait trouver dans le dévouement qu’elle a pour tous, pour son père, pour ses deux frères, pour sa belle-mère, une source de joies répétées. De son activité incessante de bru, de mère et d’épouse, de son labeur quotidien rendu harassant par leur dénuement, elle paraissait tirer une satisfaction certaine ce dont témoignait, entre autres choses, cette habitude qui était la sienne de chanter en s’adonnant à ces tâches ménagères tellement ingrates et toujours à reprendre. Même les sempiternels reproches, toujours injustes, dont sa belle-mère l’accable ne semblaient jamais l’atteindre tout à fait.
Areen, depuis cette sombre soirée, ne chante plus. Comme un automate, elle lave le sol et le linge, cuisine, range et nettoie sans être à ce qu’elle fait, indifférente à ce qui, il y a peu encore, l’occupait toute. Ses yeux si noirs ont perdu leur profondeur, une sorte de voile en a brouillé l’intensité. Est-ce à force de pleurer, se demande Mina qui, à plusieurs reprises, a surpris sa mère échevelée, l’air perdu, sa mère dont le beau visage ruisselait de larmes silencieuses. Jamais Areen n’a répondu aux questions de Mina. Elle n’a pas insisté : le regard de sa mère exprimait alors tant de douleur, tant de fièvre qu’elle a fini par renoncer, par se convaincre qu’il ne lui revenait pas de se mêler d’une affaire d’adultes.
La foule sur le trottoir est de plus en plus dense, de plus en plus bruyante. Des chauffeurs de camions s’interpellent, se disputent de trop rares espaces de livraison, des âniers malmènent leurs baudets surchargés de légumes. Des porteurs disparaissent sous des pyramides de cageots. Poussière et chaleur pèsent sur le quartier sans en réduire l’animation, sans affaiblir les cris et les appels qui montent de cette foule tout affairée.
Mina trottine, se faufile entre les chalands qui se pressent vers la grande entrée du marché dont elle est maintenant toute proche. Cette entrée, un vaste porche de pierre, porte les stigmates d’une guerre pas si ancienne dont la fillette n’a nul souvenir. Dans ce grand arc en plein cintre, elle a toujours voulu voir une énorme bouche et, dans les éclats infligés à la pierre par la mitraille, des dents endommagées comme le sont celles de sa grand-mère qui n’a plus dans la bouche que des sortes de picots noirs.
Ce matin, Mina n’a pas un regard pour la grande bouche qui avale pourtant, comme chaque jour, son lot de victuailles et d’humains. Elle est en mission. Rien ne doit l’en distraire puisque c’est à Dieu lui-même qu’elle devrait en rendre compte. Non seulement Abou Assim le lui a dit et répété mais le grand Imam, ce matin, a usé des mêmes mots. Exactement. « C’est à Dieu lui-même qu’elle aura à rendre compte » ! L’Imam aux yeux pleins de fièvre a dit ça de sa voix terrible, caverneuse et c’est à peu près tout ce que l’enfant a retenu du petit discours qu’il lui a tenu. La présence de ce grand dignitaire dans leur plus que modeste logement était, en elle-même, un événement tout à fait incroyable. Et qu’il s’adressât à elle directement, à elle insignifiante petite bonne femme, l’était bien davantage encore. À quoi devait-elle cet honneur qu’on lui faisait ? Comment se pouvait-il que pour une mission dont l’exécution lui paraissait aussi simple, un si grand homme tellement impressionnant qu’elle n’avait jamais pu lever son regard sur lui, ait pu se déranger personnellement ? « Puis-je compter sur toi, avait demandé le Saint homme dont les paroles résonnaient comme s’il se fût exprimé depuis le fond d’une grotte ? » De sa voix de souris, Mina avait récité sans trop d’hésitations le petit couplet qu’on lui avait fait apprendre et réciter des dizaines de fois. Oui, elle saurait choisir le meilleur moment, oui, elle attendrait d’être entourée du plus grand nombre possible de badauds, non, elle ne tremblerait pas. Son amour du Prophète lui donnerait toute la force nécessaire… Visiblement satisfait, le religieux avait félicité son père qui se tenait entre ses deux frères, un peu en retrait, raide comme un piquet, à demi pétrifié par l’honneur qu’on lui rendait. « Tu as bien de la chance, Abou Ali, avec cette petite, Dieu t’a distingué toi et toute ta descendance. » Sur ces paroles prononcées avec une gravité dont il ne savait sans doute se départir, le grand homme, plein de majesté, avait quitté la pièce en saluant au passage, d’un petit geste de la main, la grand-mère de Mina qui assistait à la scène. Ivre de fierté, éperdu de reconnaissance, Abou Ali avait raccompagné le religieux jusqu’à la grille.
Personne, pas même sa fille trop impressionnée par la présence sous son toit du grand dignitaire, n’avait prêté attention aux sanglots étouffés qu’Areen émettait depuis la pièce voisine où son mari l’avait enfermée.
Les choses ensuite n’avaient pas traîné. C’est Abou Assim qui avait préparé la petite, qui lui avait ôté sa robe, fait endosser ce harnais qu’on lui avait fait essayer la veille mais sans les tubes jaunes qui remplissaient maintenant les petites sacoches cylindriques. Mina n’avait pas posé de questions. Obéir lui était naturel et ce qu’on attendait d’elle tellement simple. Son oncle lui avait montré une dernière fois par où devait passer la cordelette terminée par une petite boule de plastique et rappelé qu’elle devait l’avoir toujours en main. Mina avait ensuite remis sa robe, ajusté son hijab sans l’aide de son oncle.
Mina musarde maintenant entre les étals, s’émerveille de la profusion de fruits et de légumes que les marchands arrosent pour rendre plus éclatante encore leurs couleurs et plus évidente leur fraîcheur. La foule se fait de plus en plus dense, les conversations, les discussions de plus en plus vives. Des plateaux chargés de tasses de thé circulent à bout de bras au-dessus des têtes. Deux policiers armés, l’air soupçonneux, se fraient difficilement un passage dans les allées encombrées. Mina s’arrête devant l’étal qu’elle préfère entre tous, celui de Mansour, le marchand d’épices. Elle aime le commerçant pour lui-même, pour sa bonhomie, pour son mince filet de voix qui semble appartenir à un enfant plein de malice. Mansour est minuscule, agité et fébrile comme un fennec. Il a toujours pour elle une plaisanterie dans son sac ou une devinette qu’elle adore rapporter à la maison. Il l’appelle « ma perdrix » ou « ma caille » selon les jours. Elle aime aussi ces petites montagnes d’épices aux couleurs si vives, leurs odeurs mêlées, entêtantes lui paraissent pleines du mystère de leurs origines. Le marchand lui a appris à les reconnaître et leurs noms enchantent la fillette : la badiane chinoise, la cardamome verte, l’aneth doux et le merveilleux safran d’un jaune si lumineux et combien d’autres. Mansour a gagné sa confiance, Mansour est son ami et jamais elle ne passerait par le marché sans saluer le vieil homme. Son étal est aussi l’un des mieux achalandés, on s’y presse pour faire provision de curry ou d’origan, de laurier des Indes ou de muscade, on s’y amuse aussi des pitreries du bonhomme et de ses reparties qui font mouche. De l’ouverture du marché à sa fermeture, en début d’après-midi, le stand de l’épicier ne désemplit pas. Ce matin-là comme tous les autres, sur trois ou quatre rangs, simples badauds ou vrais clients encerclent l’étal de Mansour. Si lui en venait l’idée, Mina aurait toutes les peines à se frayer un chemin, à s’extraire de cet attroupement mais elle n’y pense pas. Son temps n’est pas compté. Et puis son ami est aux prises avec un de ses chalands, un jeune homme à l’allure assez distinguée mais dont le verbe haut, à l’évidence, lui déplaît. Ils disputent de politique. Enfin, c’est ce qu’il semble à Mina qui s’intéresse moins au sujet de la discussion qu’aux singeries de son ami qui a, d’avance, le soutien de son public. Ses reparties les plus pertinentes sont même parfois saluées d’applaudissements.
La petite boule de plastique que Mina sent sous sa robe lui rappelle soudain qu’elle n’est pas là pour billebauder comme les autres jours ni seulement pour écouter Mansour et se tordre de rire. Dieu compte sur elle. Le terrible Imam l’a dit de sa voix d’outre-tombe qui semblait sortir de derrière le rideau de jais de sa barbe posée comme un glaive sur l’avant de sa poitrine.
Un frisson d’anxiété la saisit brièvement. Mais non, elle n’a aucune raison de s’inquiéter, tout est en ordre. La foule toujours bien dense qui l’entoure la rassure. Dieu n’aura pas à se plaindre.
Liens externes
modifier